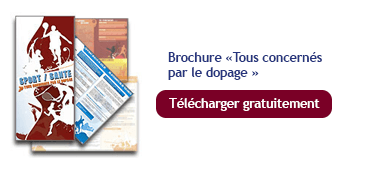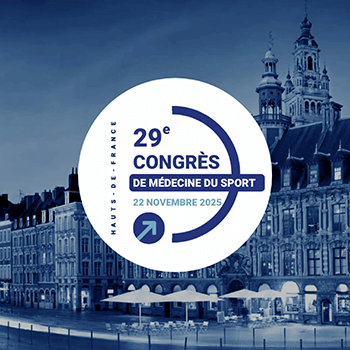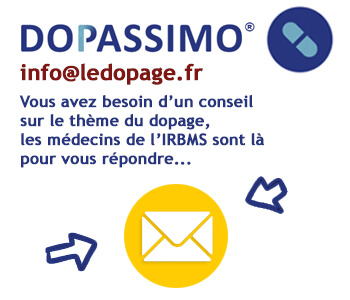Créatine : quelle toxicité potentielle ?
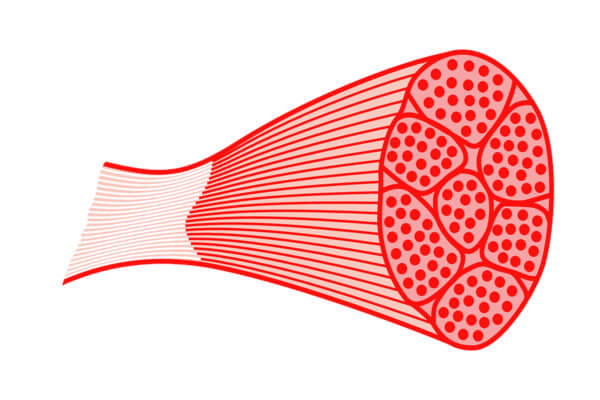
Les adolescents, personnes âgées ou présentant des pathologies de santé (rénales en particulier) doivent rester prudentes et relèvent d’une surveillance médicale.
Les références scientifiques complètes citées dans cet article sont disponibles dans notre bibliographie consacrée à ce thème.
De nombreuses études récentes sont en faveur d’un usage relativement sécurisé de la créatine, sous réserve d’une part, que les doses consommées soient adaptées et d’autre part, que le consommateur soit en bonne santé sans facteur de vulnérabilité.
Cette innocuité relative de la créatine est vérifiée dans la revue biblio de BUTTS & all de 1980 à 2017 avec toutefois une prudence requise devant le manque d’étude à long terme.
La Société Internationale de Nutrition du Sport va plus loin et souligne que la tolérance est bonne et bien tolérée chez les adultes en bonne santé, même à des doses élevées de l’ordre de 30g/jour. Certaines populations d’actifs tels que les adolescents, personnes âgées ou présentant des pathologies de santé (rénales en particulier) doivent rester prudentes et relèvent d’une surveillance médicale.
Concernant les effets rénaux ou hépatiques, la revue biblio de DE GUIGAND regroupant 666 études ne retrouve pas d’effet indésirable observé lors de supplémentation en créatine.
La revue de 2018 de KIDNEY & all reprenant les résultats de 19 études sur des bodybuilders a étudié spécifiquement les effets rénaux potentiels. Il n’y a pas été mis en évidence d’altération de la fonction rénale après des supplémentations de 5 à 30g/jour, sur une période d’observation allant de 5 jours à 5 ans. Les auteurs préconisent toutefois de ne pas utiliser de supplémentation chez les sportifs atteints d’une maladie ou dysfonctionnement rénal.
Même si la supplémentation en créatine semble bien tolérée aux doses recommandées, une surveillance nutritionnelle et médicale s’impose (foie et rein) PORTMANS & al. 2000 KIDNEY & al. 2018).
Enfin il faut également considérer que les effets secondaires observés lors d’une supplémentation en créatine relèvent plus au régime hyperprotéiné dû ou associé à cette supplémentation, en particulier à forte dose. Raison pour laquelle la consommation de créatine doit s’inscrire dans une stratégie nutritionnelle globale, en cohérence avec l’alimentation quotidienne.
Les raisons de rester prudent !
Un effet délétère peut s’observer sur la fonction respiratoire, lors d’une supplémentation en créatine à dose adaptée de 5g/jour pendant 7 semaines chez des jeunes sportifs. Cette supplémentation en créatine peut déclencher une hyper réactivité bronchique avec altération du volume expiratoire maximal, ceci de façon plus importante chez les sujets connus atopiques. L’usage de la créatine doit être évitée ou limitée chez le sportif allergique ou asthmatique.
Certains effets secondaires tels que les crampes musculaires, troubles hépatiques, troubles rénaux, hypertension artérielle et pathologies cardiovasculaires, ont été décrits en bibliographie (OSTOIJC & al.). Il semble que la supplémentation en créatine puisse être un facteur déclenchant de pathologies chez les sujets prédisposés.
Une possible rétention d’eau incite à la prudence dans les sports à catégories de poids.
En dehors du monohydrate de créatine, il existe de nouvelles formes de créatine sur le marché, formes plus ou moins associées à d’autres substances. Ces nouvelles créatines incitent à la plus grande prudence, en raison de leur innocuité non démontrée et d’absence de recul suffisant (ANDRES & al. JAGER & al.).
L’excès de créatine consommé sous forme de suppléments alimentaires, en particulier à forte dose, est métabolisé en différents métabolites dont certains sont de nature à être cancérigène (amines hétérocycliques), dont les effets chroniques ne sont pas exclus, à fortiori lors d’une exposition répétée. Ce risque reste controversé. Il est remis en cause dans certaines études mais le recul n’est pas assez important pour vérifier l’innocuité du produit (PEREIRA & al.). Ce risque cancérigène reste à ce jour mal défini, car mal apprécié à long terme et doit inciter à éviter les doses élevées.
Enfin, il existe également une toxicité associée, par la contamination possible par des produits dopants ou de toxiques, en rapport avec le mode de fabrication ne respectant pas toujours les règles sanitaires dans certains pays de fabrication.
La contamination peut également être d’une autre nature en fonction du mode d’extraction de la créatine. Actuellement élaborée en laboratoire (créatine de synthèse), l’éventualité d’une origine animale ne se conçoit plus de nos jours. Celle-ci laisse suspecter une contamination possible par des maladies animales (dont le prion de l’ESB source de maladie de Kreutsfeld Jacobs). Cette alerte sanitaire avait d’ailleurs été prononcée par le Ministère dès 1998.
Pour limiter le risque de contamination par un produits dopant, il est indispensable de privilégier les suppléments de créatine possédant la norme de sécurisation AFNOR NF 17444.
Le conseil de l’IRBMS : limiter les effets secondaires de la créatine ?
- Avant de penser à la créatine, l’amélioration des performances (ergogéniques ou prise de masse musculaire) passera avant tout par des apports protéinés et énergétiques adaptés dans votre équilibre alimentaire quotidien et vos rations d’effort/récupération.
- En cas de consommation de créatine, il convient de privilégier le monohydrate de créatine aux autres formulations.
- L’absence d’efficacité supplémentaire de la créatine à fortes doses incite à préconiser un faible dosage de 1 à 3g/jour, reconnu tout aussi efficace sur l’augmentation des performances et sur le développement de la masse musculaire qu’à des dosages plus élevés.
- Au vu de la littérature, la supplémentation en créatine est relativement bien tolérée aux doses recommandées de 1, 3 à 5g/jour.
- Un suivi médical et/ou nutritionnel s’impose en cas de vulnérabilité ou problèmes de santé, ainsi que chez le consommateur jeune ou âgé.
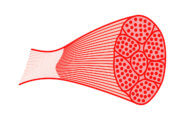 A lire également
A lire également
Notre dossier thématique complet sur la Créatine : C’est quoi ?, Performances, Toxicité, Intérêt chez le sportif végétarien ?, Bibliographie…
© IRBMS - Droits de reproduction
► Recevoir notre Newsletter